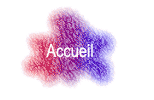
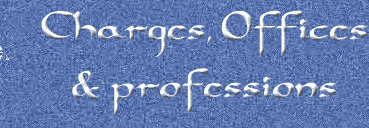

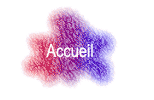 |
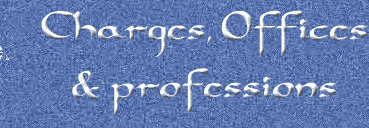  |
|
| Thèmes A B C D E F G H IJK L M N O PQ R S T UV WXYZ |
| Action de rendre les métaux précieux plus purs et plus fins. A plusieurs reprises des offices d'affineurs furent créés. | ||
| Officier chargé de fixer le prix du vin | ||
|
|
Les agents de change faisaient commerce des effets
royaux et publics. Un arrêt du conseil de 1595 fixe leur nombre à
8 pour Paris, 12 à Lyon, 4 à Rouen et Marseille,
3 à Tours, La Rochelle et Bordeaux. et leur
interdit d'exercer la profession sans lettres
de provision du roi. En 1638 la charge ne vaut encore que 1 500 livres mais en 1705 Louis XIV remplace ces 36 offices par 20 autres valant chacun 60 000 livres. Seuls une dizaine de candidats se présentèrent. Les années suivantes furent une succession de créations, suppressions, nominations par commission...mais globalement leur nombre augmente. Lorsque la Bourse de Paris fut créée en 1724, leurs fonctions furent strictement réglementées : toute transaction boursière faite sans leur ministère est nulle. |
|
| Charge qui donnait autorité et juridiction, au civil comme au criminel, sur les côtes, flottes et armées de mer. Il s'agissait de l'une des grandes charges de la couronne et à chaque nouvelle annexion de provinces maritimes (Provence, Bretagne, Guyenne) un amiral y fut nommé. Celui de Provence, était nommé "Amiral des mers du Levant". Richelieu, pour qui le domaine maritime était de toute première importance acheta la charge de Grand Amiral puis racheta également peu à peu toutes celles des petites amirautés telles que Brest, Belle-île, Le Havre... pour ensuite, sous le titre de "Chef et surintendant de la navigation et du commerce de France" prendre l'autorité suprême sur les hommes et choses de la mer | ||
| Droit dû aux mesureurs de bois | ||
|
Unie à la corporation
des épiciers, la corporation des apothicaires faisait pourtant
très mauvais ménage avec elle car le sucre, très
rare au moyen-âge, était considéré comme un
médicament. Ce sont les épiciers qui étaient chargés
de fournir aux apothicaires la plupart des ingrédients nécessaires
à la préparation de leurs remèdes, se chargeant également
d'importer les marchandises parfois de très loin. D'où de
nombreux conflits découlant de ce monopole et conduisant les apothicaires
à revendiquer les mêmes droits. |
||
| Le plus bas de degré dans la hiérarchie corporative. L'apprentissage avait pour but de former de bons ouvriers, d'en contrôler le nombre, et d'apporter une aide peu onéreuse aux compagnons et maîtres | ||
|
|
Profession très répandue dans la France d'ancien régime qui consistait à mesurer les terres (arpenter). Par un édit de 1554, chaque bailliage ou sénéchaussée devait créer 6 offices d'arpenteur dépendant du "Grand arpenteur de France" (charge supprimée en 1683) et en 1762, un autre créait 2 charges d'arpenteurs par bailliage et en chaque autre ville. | |
| Premier dignitaire ecclésiastique de la cour, il dirige toute la maison ecclésiastique du Roi. Il est gouverneur-né de l'Ordre du St Esprit, et dispose de différentes bourses dans les collèges parisiens. | ||
| La profession d'avocat nécessitait d'être licencié en droit civil ou canonique et de prêter serment. Les avocats généraux du Parlement, les avocats du roi des autres tribunaux était érigés en offices et prenaient rang après les procureurs généraux. | ||
| La fonction de bailli, homme
d'épée et agent royal a été créée
au 13e siècle pour contrôler la gestion locale des prévôts.
D'abord inspecteurs itinérants, ils quittent bientôt la cour
du roi et s'installent dans leur ressort d'inspection. A la fin du moyen
âge, la fonction de bailli était très importante puisqu'il
exerçait alors tous les pouvoirs politiques, administratifs, financiers,
judiciaires et militaires. Il surveillait les agents locaux, centralisait
les recettes et rendait compte de sa gestion à la Chambre
des Comptes. Au fil du temps, pour faire face à la multiplication et la complexité croissante des affaires il devint nécessaire de recruter d'autres fonctionnaires plus spécialisés (gouverneurs, maîtres des Eaux & Forêts, receveurs, trésoriers...), ce qui finalement a considérablement restreint ses attributions. Au 18e siècle, le peu de pouvoir qu'il lui restait est transféré aux gouverneurs. |
||
| Nom quelquefois donné aux juges des justices seigneuriales de Provence. | ||
| Officier chargé de procurer au Trésor les avances dont il avait continuellement besoin. Le poste fut supprimé sous le ministère Turgot. | ||
| Corporation qui se détacha des barbiers-chirurgiens en 1637 et qui avait pour enseigne un bassin blanc (tandis que les barbiers-chirurgiens avaient un bassin jaune). L'usage de la perruque et les besoins en toilette occasionnés par la mode expliquent l'importance et la richesse de cette corporation. | ||
| Corporation
qui se détacha des barbiers-perruquiers
en 1637 et qui avait pour enseigne un bassin jaune (tandis que les barbiers-perruquiers
avaient un bassin blanc). Les médecins qui au moyen-âge ne pouvaient verser le sang (seuls les clercs étaient hommes d'étude et l'église le leur interdisait) voyaient d'un très mauvais oeil cette corporation. Les barbiers-chirurgiens ne pouvaient être bacheliers, licenciés ou docteurs, mais seulement "aspirant" ou "maître". Pourtant, la chirurgie était souvent exercée avec art et connaissait même quelques succès malgré les connaissances rudimentaires de l'époque. Progressivement les chirurgiens se sont détachés des barbiers et en 1699 leur indépendance vis-à-vis de la faculté de médecine fut proclamée même s'ils étaient toujours tenus par arrêt du Parlement, de porter honneur et respect aux médecins. En 1731, la création de l'Académie de chirurgie permit à la profession de s'affranchir complètement de la médecine et par une ordonnance de 1743, la scission chirurgie/barberie s'opèra officiellement en exigeant des chirurgiers un diplôme de Maître es arts et en interdisant aux barbiers l'art de guérir. Enfin, en 1756, un arrêt du conseil leur donne les titre et privilèges de notables bourgeois, le droit d'être pourvu en offices municipaux, l'exemption de corvées, du vingtième d'industrie et quelques autres charges publiques. |
||
| Communauté de clercs dépendant des cours de justice, principalement composée de jeunes juristes (procureurs & clercs de notaires) encore en apprentissage et qui arpentaient les Palais de Justice | ||
| Sous l'ancien régime, les voies navigables
fourmillent de bâteliers. Ils constituent un maillon indispensable
au commerce intérieur car à cette époque, les routes
étant pratiquement inexistantes il n'existe pas d'autres alternative
à la voie d'eau. Hommes à mauvaise réputation, les
bâteliers n'en exercent pas moins un métier difficile sans
cesse obligés de se plier aux caprices des fleuves (qu'il s'agisse
de crues, sécheresse, vents), ou de tenir compte des autres utilisateurs
des fleuves tels les meuniers ou les pêcheurs avec lesquels les
conflits sont nombreux. |
||
| L'office de
bourreau était souvent mal considéré et il devait être
domicilié à l'extérieur de la ville où il exerçait.
Il jouissait de certains droits particuliers, dont celui de havage.
A Bourges, au 18e siècle un bourreau était payé 5 l. pour attacher au carcan, 7 l pour fouetter et marquer, 10 l pour couper ou percer la langue, 20 l pour pendre, 30 l pour rouer ou décapiter... Ces tarifs pouvaient varier d'une région à une autre. |
||
| Paysan qui n'avait, pour travailler ses terres, que la force de ses bras. (le laboureur disposait d'un attelage). Il ne possède pratiquement pas de terre et loue ses services auprès de plus riches que lui. | ||
| Privilège accordé à un officier de se voir rembourser par son successeur tout ou partie de la valeur de sa charge. | ||
| La charge de "buvetier du palais" d'abord créée à la Grand'chambre fut peu à peu étendue aux autres chambres du parlement et Cours Souveraines. Il semble qu'elle ait joué un grand rôle dans la vie judiciaire d'alors et que l'abus d'alcool ait dicté nombre de jugements. | ||
| Sous l'ancien régime, il y avait 3 sortes de cabarets
: * à pot et à pinte (ne vendait qu'à boire) * à pot et assiette (restauration) * et ceux qui logeaient.Des règlements de police avaient fixé leurs obligations de manière très précise : interdiction de donner à boire et à manger les dimanches et jours de fêtes pendant la messe et les vêpres, refuser les gens mariés, leurs enfants et domestiques s'ils habitent à moins d'une lieue, ne recevoir personne après 20 heures l'hiver, 22 heures l'été... mais ces règlements n'étaient que peu suivis et les cabarets étaient souvent accusés d'être des lieux de débauche accueillant tout ce que les routes pouvaient connaître de brigands. Soumis à d'importants droits d'Aides sur les boissons, les cabaretiers pouvaient souscrire un abonnement auprès de la ferme |
||
| En 1682, des compagnies de cadets-gentilhommes voient
le jour à l'initiative de Louvois. Créées
à Besançon, Brisach, Cambrai, Givet, Longwy, Metz, Strasbourg,
Tournai, Valenciennes. Les jeunes recrues devaient être âgées
de 15 à 24 ans ils devaient être soit nobles, soit de la
haute bourgeoisie si leur famille avait les moyens d'entretenir une charge
d'officier. |
||
| Sceaux et Poissy étaient les deux principaux marchés approvisionnant Paris en bétail. Dès 1690, des officiers "trésoriers de la bourse des marchands de Sceaux et Poissy" ont servi d'intermédiaire entre les marchands de bestiaux parisiens et les bouchers. Ces jurés vendeurs recevaient un sou par livre des bestiaux qui se consommaient à Paris. Si l'objectif avoué fut d'améliorer l'approvisionnement et de permettre aux marchands d'être rapidement payés, l'objectif inavoué eut la fâcheuse conséquence de faire augmenter le prix de la viande dans la capitale. Ce droit fut supprimé en 1743 mais rapidement rétabli l'Etat ayant besoin de fonds pour faire face aux dépenses de guerre | ||
| centième
denier des offices |
Taxe annuelle se montant à 1 % de la valeur d'un office, établie à la place de la paulette en 1771 | |
| Expert-juré chargé de fixer les limites des héritages. Le cerquemenage était le droit qu'on lui payait pour ses déplacements et service. | ||
| Grand officier de la couronne commandant à tous les
officiers de la chambre et de la garde-robe du roi. Très important depuis les origines de la monarchie française, à la fin de l'ancien régime il n'avait plus qu'un rôle de cérémonie. |
||
| Le Chancelier de France était depuis 1627 le premier
des grands officiers de la couronne.
Inamovible, chef de la justice, des conseils du roi, président de
tous les tribunaux, porte-parole du roi dans les lits
de justice, il n'était justiciable que du roi. Pour marquer que
la justice ne cesse jamais il ne prenait pas le deuil du roi et n'assistait
pas à ses obsèques. L'une de ses fonctions les plus importantes était d'apposer le sceau de l'état dont il avait la garde sur les édits bien qu'il y eut parfois simultanément un chancelier et un garde des sceaux, le premier l'emportant en dignité, le second en pouvoir réel. Toutes les lettres patentes étant soumises au chancelier et revêtues du grand sceau, le contrôle ne s'exerçait pas seulement sur la forme mais également sur le fond : dans le cas où il estimait que la décision du roi était contraire aux ordonnances, aux traditions ou simplement à l'intérêt du royaume. Son devoir était alors de formuler des des remontrances au roi. D'ailleurs, le roi souvent sollicité par des courtisans avides cède souvent à leurs sollicitations dans le seul but que le chancelier refuse d'obéir. En tant que superintendant de la justice le chancelier est également chef de la magistrature et conciliateur entre le roi et les cours souveraines tout comme il participe à l'administration générale du royaume en jouant un rôle très important dans les conseils même si au quotidien ce rôle incombe davantage aux secrétaires d'état Du Chancelier dépendait également le bureau de la librairie où il nommait les censeurs, donnait permissions et privilèges pour imprimer et avait sous son autorité les Universités, collèges et académies. |
||
| L'office de changeur consistait à recevoir et changer les monnaies étrangères ou démonétisées. Créé en 1555, il fut tour à tour supprimé, rétabli, et en 1696, un édit institua 300 changeurs en titre d'office héréditaire. | ||
| Mot passe-partout équivalent de "fonction". Certaines charges étaient des offices (souvent vénaux), d'autres des dignités ou des commissions. | ||
| Charges importantes conférant la noblesse à leur titulaire, soit immédiatement (premier degré), soit après un certain nombre d'années d'exercice ou de générations passées à excercer la même fonction. Les secrétaires du roi, les fonctions municipales (noblesse de cloche), les magistrats, maîtres de requête, trésoriers de France (noblesse de robe) étaient des charges anoblissantes. | ||
|
|
Officiers de la chancellerie chargés de préparer la cire pour sceller les actes royaux auprès du chancelier ou garde des sceaux. | |
| Officier général de la mer équivalent au Maréchal de camp des armées de terre. C'est sous Louis XIII que l'office est créé en 1627 d'abord à Brest (Bretagne), Brouage (Guyenne) et au Havre (Normandie). Officiers d'épée ils partagent leur autorité avec un commissaire général, officier de plume. En 1635, un chef d'escadre est nommé en Provence, puis en Aunis, Flandre (Dunkerque), en Languedoc, Picardie, Poitou-Saintonge, Roussillon | ||
| A l'origine, gentilhomme attaché à la personne du roi ou de la reine mais un édit de 1691 créa des offices de Chevalier d'honneur auprès des Présidiaux pour participer aux séances épée au côté aussitôt après les lieutenants généraux et avant les conseillers. L'édit invoque la raison qu'il y a des gentilhommes dont l'âge ou l'état de santé ne permet pas de servir dans l'armée et qui néanmoins voudraient être de quelque utilité au bien de la justice. Il eut été plus simple de dire que le fisc avait surtout besoin de vendre des charges et que celle-ci n'avait pas encore été créée. | ||
|
|
Visites de contrôle effectuées à cheval que certains officiers du roi devaient effectuer pour satisfaire aux devoirs de leur charge. Les chevauchées des maîtres de requête ont peu à peu permis aux intendants de s'établir en province. | |
| Initialement intégrés à
la communauté des barbiers
car tenus éloignés par la communauté des médecins,
les débuts du métier de chirurgien furent des plus humbles.
Les barbiers-chirurgiens ne
pouvaient être bacheliers, licenciés ou docteurs,
mais seulement "aspirant" ou "maître". Pourtant,
la chirurgie était souvent exercée avec art et connaissait
même quelques succès malgré les connaissances rudimentaires
de l'époque. Progressivement, les chirurgiens se sont détachés des barbiers pour s'élever dans la hiérarchie et en 1699, leur indépendance vis-à-vis de la faculté de médecine fut proclamée même s'ils étaient toujours tenus par arrêt du Parlement, de porter honneur et respect aux médecins. En 1731, la création de l'Académie de chirurgie permit à la profession de s'affranchir complètement de la médecine et par une ordonnance de 1743, la scission chirurgie/barberie s'opéra officiellement en exigeant des chirurgiens un diplôme de Maître es arts et en interdisant aux barbiers l'art de guérir. Enfin, en 1756, un arrêt du conseil leur donne les titre et privilèges de notables bourgeois, le droit d'être pourvu en offices municipaux, l'exemption de corvées, du vingtième d'industrie et quelques autres charges publiques |
||
|
|
Habitant chargé (à tour de rôle)
d'établir l'assiette et le recouvrement
de la taille dans leur paroisse. Il était
élu lors d'une assemblée de la paroisse, ou à défaut
nommé d'office par l'intendant
car la charge était tellement
redoutée que les personnes aisées n'hésitaient pas
à quitter les campagnes pour y échapper L'exemption de collecte (accordée aux septuagénaires, infirmes, pères de 8 enfants, marguilliers et syndic pendant leur temps de service, maître d'école, médecin, sacristain et maître de poste...) était encore plus enviée que l'exemption de taille car la fonction rendait le collecteur odieux, l'empêchait pendant environ 2 ans (la taille ne rentre jamais dans l'année courante) de vaquer à ses propres affaires et surtout parce que les responsabilités qui pesaient sur lui, énormes, lui permettaient rarement d'échapper aux saisies voire même à l'emprisonnement. |
|
| Le métier de colporteur, toujours suspect, était soumis à une réglementation très stricte. Depuis 1723, ils devaient savoir lire et écrire et être munis d'une permission du lieutenant général de police. Pour ne pas concurrencer les libraires, ils ne pouvaient avoir ni magasin, ni boutique, ni apprenti et ne pouvaient vendre que les édits, des almanachs et des petits livres n'ayant pas plus de 8 feuilles. Pour les autres objets, il y avait toutes sortes de marchands ambulants souvent mal vus des communautés de marchands des villes, des colporteurs de loteries, charlatans, montreurs d'ours et autres animaux.... | ||
| Un fort préjugé était ressenti à l'égard des comédiens. Louis XIII, tenta de les gommer par une déclaration de 1641 dans laquelle il demandait à ce que les comédiens ne soient pas inquiétés ni blâmés à condition qu'ils respectent la loi, soient honnêtes, et n'usent pas de paroles pouvant blesser l'honnêteté publique. Malgré tout, les censures ecclésiastiques étaient toujours d'actualité et les derniers sacrements pouvaient être refusés aux comédiens. De peur d'être inquiétés ils se mariaient souvent en faisant état de la profession de musicien. | ||
| Adjoint au gouverneur qui prit parfois toute l'autorité dans certaines provinces, la partageant avec l'intendant dont les fonctions avaient moins d'éclat mais étaient plus importantes. | ||
| Le titre très convoité de Commensal
du roi n'était donné qu'aux officiers
et domestiques de la maison
du roi et des maisons royales. Etaient donc commensaux les grands officiers
de la couronne, maîtres d'hôtel, gentilhommes
servants, valets de chambre, aumônier, officiers de la fauconnerie,
ouveterie, gardes du corps....mais aussi les officiers des cours souveraines,
les avocats au conseil, les trésoriers
de France et officiers des bureaux
des finances...et les centaines de commensaux de second et troisième
rang, tels les médecins ordinaires,
huissiers, marchands suivant la cour... Leurs privilèges étaient importants : droit de committimus, exemption de logement des gens de guerre, de tutelle et curatelle, de corvées, collecte, droit de gros, exemptions de taille... |
||
| Terme qui s'applique plus particulièrement aux employés de la ferme générale et à ceux de la régie des domaines et des aides. Les plus impopulaires étaient ceux de la gabelle et des aides. Les commis devaient avoir 20 ans, prêter serment et être de religion catholique car leurs procès-verbaux faisaient foi et ils avaient le droit d'être armés. Ils étaient exempts de taille et de logement de gens de guerre. Derrière ce titre, semblant bien modeste aujourd'hui, se trouvaient en réalité des administrateurs de haut-rang, gens de plume ayant souvent pignon sur rue dans leur ville ou région. | ||
| Contrairement à l'officier, un commissaire est un agent chargé par le roi d'une mission temporaire et révocable. nommé par lettre patente, longue et détaillée car elle comportent l'énumération précise et limitative des pouvoirs du commissaire. La commission s'éteignait par décès du commissaire. | ||
| Officiers de police qui remplissaient à peu près les fonctions des commissaires de police : surveillance des hôtels, marchés, réception des plaintes des victimes de vol, injures... ils apposaient les scellés après décès... | ||
| Pouvoir, par laquelle il le prie de mettre à exécution quelque mandement, décret ou appointement de justice dans l'étendue de sa juridiction |
||
| Une fois son apprentissage terminé l'apprenti entrait en compagnonnage pour une durée de 1 à 6 ans. Le compagnon travaillait en tant que salarié chez un maître pour une durée préalablement fixée et attestée dans un livret dont le port était obligatoire depuis 1781. Pour les fils de maîtres, la durée était réduite et souvent même les apprentis pouvaient passer maîtres sans avoir été compagnons. La réception en tant que maître se faisait suite à la réalisation d'un "chef-d'oeuvre". | ||
| Le concierge, ultérieurement appelé le "bailli du Palais" était un officier qui exerçait sa juridiction à l'intérieur du palais. Il y connaissait les crimes et délits, les contrats et les marchés qui s'y passaient. | ||
| Chef suprême de l'armée en l'absence
du roi. Son avis devait être pris pour tout ce qui concernait la guerre
et ses droits étaient considérables. Il avait la propriété
des armures restées sur le champ de bataille et de tout ce qui se
trouvait dans les villes et forteresses conquises, sauf l'or et les prisonniers
qui étaient au roi ainsi que les objets en métal qui étaient
au grand maître de l'artillerie. Il disposait de son propre tribunal,
la Connétablie où il jugeait les délits des gens de
guerre. Richelieu supprima cette dignité bien trop puissante à la mort du dernier Connétable de Lesdiguières en 1627. |
||
| Grands officiers de la couronne, gouverneurs de province, lieutenants généraux, premiers présidents des cours souveraines, présidents à mortier du parlement de Paris... autant de hauts personnages auxquels le roi a conféré un pouvoir honorifique de "conseiller du roi en ses conseils" même s'ils n'ont plus accès aux conseils depuis 1673. | ||
| Les vrais conseillers d'état qui ont séance
aux conseils incluent des membres de droit : * des ducs & pairs juges-nés de tous les tribunaux suprêmes mais que Louis XIV a cantonnés au Conseil privé où l'on fait du contentieux et non de la politique * des ministres d'état, secrétaires d'état et contrôleur général des finances * les intendants des finances et des membres titulaires : personnel fixe et actif du conseil qui n'ont pas le droit, mais le devoir de siéger. Ils sont au nombre de 24 conseillers tutélaires de robe recrutés parmi les maîtres de requête, les intendants de province et la haute magistrature, 3 conseillers d'église (archevêque ou évêque), et 3 conseillers d'épée (aristocratie militaire) nommés par lettres patentes à une charge de dignité. |
||
| Titre de peu de signification très largement utilisé par le pouvoir royal qui le vendait de manière à parer quelque office d'un titre honorifique. Etaient conseillers du roi tous les officiers des cours souveraines, des présidiaux, des bailliages et sénéchaussées, les trésoriers de France, les notaires et les commissaires au Châtelet, ainsi que quantité de trésoriers, receveurs, payeurs... Le terme de conseiller du roi ne doit pas être confondu avec ceux de conseiller d'état ou secrétaire du roi. | ||
| Officiers
dont le titre a été surexploité par la fiscalité
royale qui y voyait un moyen efficace de faire rentrer l'argent dans les
caisses de l'état. Il y eut pléthore de contrôleurs...
contrôleurs des eaux et forêts,
contrôleurs généraux des domaines
et bois, contrôleurs des guerres, contrôleur des monnaies de
France, de rentes (contrôlaient
les payeurs de rente), contrôleurs généraux des gabelles
du Dauphiné, des gabelles du Languedoc, des greniers
à sel du Languedoc qui exerçaient un droit d'inspection
sur le débit du sel dans ces pays de petite gabelle. La ferme avait des contrôleurs des aides, des contrôleurs sédentaires et ambulants des domaines, des contrôleurs généraux des fermes, du vingtième... |
||
|
Commission (à ce niveau on évitait de créér des offices) créée par Colbert en 1661 après que la surintendance des finances ait disparue. Le contrôleur général des finances était à la tête de l'administration financière mais également de l'agriculture, l'industrie, les ponts et chaussées, le commerce, et toute l'administration intérieure du royaume. Sa correspondance avec les intendants faisait de lui une sorte de ministre de l'intérieur. Au 18e siècle, son prestige diminua peu à peu jusqu'à sa suppression à la révolution. |
||
| Ce que l'on appelle aujourd'hui "corporation". Jusqu'à la révolution il existe des corps royaux, provinciaux, coutumiers, municipaux, professionnels, savants, médicaux...qui imposaient leurs lois, leurs règles, rites, usages à la justice, à la vie économique, et... au pouvoir royal. Les corporations étaient vraiment "intermédiaire" entre le roi et l'individu qu'elles encadrait et protégeait. Elles n'avaient pas besoin de résister au pouvoir royal, tant ce dernier les ménageait. | ||
| Enlever son office ou sa dignité à quelqu'un. Elle concernait indifféremment nobles ou ecclésiastiques. |
||
| Charge de la Maison du roi érigée en office sous Henri III. Le Grand Ecuyer de France gérait les écuries et haras du roi, en réglait les dépenses et était chargé de l'instruction des jeunes | ||
| voir "gages" | ||
| Abrégé portatif des livres de factures ; registre quotidien des expéditions avec date, noms des marchands, nombre de pièces, qualité…. |
||
| Officier de la ferme générale employé à la gabelle | ||
| Rémunération attachée
à une charge ou un office
qui était généralement très modique. |
||
| Sous l'ancien régime il s'agissait du contraire de ce que l'on entend aujourd'hui. Une augmentation de gages était un moyen de contraindre un officier à verser un supplément de finances au roi, car "augmenté" il était alors contraint de verser le capital correspondant dans les caisses de l'état. |
||
|
|
Officier qui ne passe pas les actes et contrats, mais qui en conserve les notes et minutes |
|
| Grand officier de la
couronne commis par le roi pour assurer
la garde des sceaux de France et le scellement des édits
et lettres royales lorsque le chancelier
(dont c'était la fonction première) était absent. Sous Henri II, il se vit attribuer tous les honneurs et prérogatives du chancelier contre l'avis du Parlement qui n'enregistra l'édit que contraint et forcé. La fonction fut souvent intermittente du fait du caractère particulier et politique du poste qui résultait du degré de disgrâce dans lequel se trouvait le chancelier. |
||
| Sous l'ancien régime, la vérification des quartiers de noblesse avait une importance capitale car des preuves étaient exigées lors de l'obtention de certaines charges, pour l'entrée dans certains ordres, la présentation à la cour, pour monter dans le carrosse du roi....(voir Maréchal d'armes) | ||
| Travaillant souvent en partenariat avec les Trésoriers de France, les Généraux des finances étaient en charge des ressources fiscales du roi (finances extraordinaires) et s'occupaient des relations avec les officiers des greniers à sel, les receveurs généraux des finances, de tailles et d'octrois. Lorsqu'en 1577 les bureaux des finances furent créés les deux fonctions y furent regroupées. | ||
| Magistrats chargés du ministère public, avocats, procureurs généraux dans les Parlements et autres cours souveraines ainsi que leurs substituts dans les tribunaux inférieurs. Leurs charges étaient vénales | ||
| Officier militaire qui commandait pour le roi des places, villes ou châteaux et les troupes qui y étaient en garnison. Il jouissait de la même autorité que les gouverneurs de province. | ||
| Tous les individus pourvus d'un grade obtenu dans une université : baccalauréat, licence ou doctorat en théologie, droit ou médecine ; Maîtrise ès arts. | ||
| Grand officier de la couronne, chef et surintendant général de la maison du roi. En 1789, la charge appartenait au Prince de Condé. |
||
| De Louis XI à 1755, il fut le chef et l'administrateur suprême de l'artillerie qui ne dépendait pas du secrétaire d'état à la guerre. Il vendait lui-même les charges à ses officiers et avait sa justice particulière au bailliage de l'Arsenal. Dans toute ville prise, les objets métalliques devenaient sa propriété. En 1755, les 7 régiments d'artillerie | ||
| Ministres de la justice inférieure chargés de signifier les sentences, de procéder aux saisies de biens.... |
||
| Dans les corporations, registre dans lequel on note les réceptions à la maîtrise |
||
| Livre contenant les inscriptions des apprentis dans un corps de métier |
||
| Créés en 1668 pour inspecter les troupes royales à l'exception de la Maison du roi. Choisis parmi les maréchaux de camp et les brigadiers, les inspecteurs devaient informer le Ministre de la qualité des troupes et des chevaux, s'assurer que les hommes remplissaient bien leurs obligations, juger s'il y avait lieu de remplacer armes et uniformes, et s'assurer que les officiers suivaient leurs directives. | ||
| Créés en 1670 pour la draperie, ils sont 21
en 1671 et 38 en 1715. En 1738, leurs compétences s'étendent
à la papeterie et la toilerie et en 1754 ils sont 64. Placés sous l'autorité des intendants, ils s'assurent du bon respect des réglementations mises en place par Colbert. |
||
| Représentant du pouvoir royal dans une
province et principal rouage administratif des 17e et 18e siècles.
Issus des maîtres de requête,
dont la fonction s'est peu à peu sédentarisée, ils
sont apparus pour la première fois en Bourgogne en 1592. Après une période d'adaptation au cours de laquelle leurs missions sont restées temporaires et limitées les intendants ont alors réuni les pouvoirs de justice, de police et de finances. Ils ne se bornait plus à surveiller les autres officiers, mais les avaient remplacés. D'inspecteur, il devient administrateur et le pouvoir royal reprend le pouvoir dans les provinces. Sous Richelieu, ils ont pour mission de "connaître de toutes injustices et oppressions que les sujets du roi pourraient souffrir des officiers et ministres de la justice par corruption, négligence, ignorance ou autre..." Bien sûr, ils sont détestés des cours souveraines et de la noblesse et l 'un des plus grands désirs de la Fronde fut de s'en débarrasser. Mais c'est sous Colbert que la fonction a pris vraiment pris toute sa dimension. Les intendants sont alors devenus les agents les plus dévoués du pouvoir royal, nommant eux mêmes leurs subdélégués. Leurs attributions sont alors quasiment illimitées : * finances et répartition des impôts (droits domaniaux, taille...) * agriculture, industrie, ponts & chaussées, arts & métiers, commerce & marchés, police & ordre public, approvisionnements, état sanitaire, moralité publique & assistance, recrutement des troupes, logements des gens de guerre, milices, étapes, soldes, affaires ecclésiastiques, collèges, librairie, universités, administration municipale.... tout les concerne et ils s'occupent de tout. * justice : ils représentent la justice royale et sont au-dessus des tribunaux ordinaires que la justice ordinaire néglige (crimes & violences des gentilshommes ne restent pas impunis), ils entrent dans les tribunaux comme bon leur semble car ils sont chargés d'informer le roi de tous les abus qui s'y commettent. * ils animent l'économie provinciale en embellissant les villes, en veillant à l'amélioration de l'agriculture et- de l'élevage, à l'introduction de cultures nouvelles, au bon fonctionnement des manufactures royales.... * Au 18e siècle, ils s'efforcent de trouver des solutions aux problèmes de disettes, maladie et pauvreté, ils créent des ateliers de charité pour les chômeurs, améliorent les conditions de vie dans les prisons et les hôpitaux... Sous Louis XVI, la monarchie est souvent discréditée. Hommes du roi, les intendants subissent de plein fouet ce discrédit, car malgré l'importance de leur tâche et leurs compétences, aucune assemblée représentative n'est là pour rendre compte de leur travail ou appuyer leurs efforts. C'est cette énorme lacune qui poussera Louis XVI et son administration à créer les Assemblées provinciales de 1787. Law dira d'eux : "vous n'avez ni Parlements, ni Etats ni gouverneurs, je dirais presque ni roi ni ministres : ce sont 30 maîtres des requêtes commis aux provinces de qui dépendent le bonheur ou le malheur de ces provinces, leur abondance ou leur stérilité". |
||
| Au début du XVIIIe siècle la monarchie a créé
le Conseil du commerce, commission extraordinaire du Conseil
du roi où siégeaient en plus des membres du Conseil 12
députés des principales places commerciales et a multiplié
les Chambres de commerce et
juridictions consulaires. Créés par commission en 1708 (plus tard érigées en office), les fonctions des intendants du commerce seront d'animer les bureaux de commerce mais le poste n'est guère attrayant et ils disparaitront rapidement. |
||
| Poste équivalent au "directeur" dans un ministère.
Leur nombre varia selon les époques mais c'est en 1696 que leur charge
est érigée en office. Leur
administration financière se répartissait de la manière
suivante : fermes & aides,
domaines, ponts
& chaussées, hôpitaux,
prisons, municipalités,
messageries, taille, capitation,
vingtième, pays
d'Etats, régie des poudres et
salpêtres, Compagnie des Indes, commerce, étapes,
Trésor royal. En 1777 Necker supprime les offices mais conserve les fonctions. |
||
|
|
Charge instituée en 1623 devenue vénale en 1636. L'intendant des eaux et fontaines se chargeait de la conservation des sources, aqueducs, canaux, etc... | |
| S'occupent des marchés de la marine, des comptes, de la police des ports... Ils ne doivent pas être confondus avec les intendants des armées royales qui s'occupaient des litiges entre officiers et avaient sous leur direction les commissaires de la marine. |
||
| Ouvrier agricole qui n'a d'autres possessions que ses bras et sa force. Il est employé à la journée par différentes catégories de propriétaires terrestres |
||
| Charge créée par Louis XIII en 1615 pour satisfaire la noblesse et régler les contestations résultant des usurpations d'armoiries. Cette charge faisait suite à celle de "Maréchal d'armes". |
||
| Nom donné aux magistrats composant les juridictions
d'exception : * maîtres des ports pour les traites * trésoriers de France pour le domaine et la voirie * gruyers pour les eaux et forêts * amirautés pour les affaires de la mer.... |
||
| Dans le sud, désignait les lieutenants
généraux chargés des fonctions administratives
des sénéchaussées
depuis la fin du 16e siècle jusqu'à la fin du 17e siècle. Le juge mage, spécialiste en droit était en quelque sorte le technicien du sénéchal qui lui, appartenant à la haute noblesse a peu à peu délaissé ses attributions judiciaires pour se consacrer à l'administration et au domaine militaire, la fonction de sénéchal étant souvent cumulée avec celle de gouverneur |
||
| Corps de métiers exerçant l’autorité supérieure dans les corporations. Les membres d'une jurande sont unis par un serment les obligeant à se soumettre collectivement aux mêmes règles de travail dont les conditions sont fixées par des statuts agréés et si besoin modifiés par le pouvoir royal. |
||
|
Dans certaines régions, le laboureur désigne un paysan aisé. |
||
|
|
Officiers chargés de s'assurer si les porcs mis en vente étaient en bonne santé. |
|
| Terme aussi bien civil que militaire. |
||
| Charge
créée en 1667. Les attributions du lieutenant général
de police rejoignaient celles des intendants
pour les villes. A Paris, il partageait l'administration de la
ville avec le Prévôt
des marchands mais avait plus grand pouvoir. Chargé de gérer
l'ordre public au sens large, il s'occupait de l'approvisionnement en
blé, du contrôle des métiers, de la surveillance des
imprimeurs... |
||
| Officiers de justice établis pour gérer les droits des traites. Il y avait des maîtrises générales et des lieutenances. |
||
| Officier préposé à la police des ports de commerce sous la responsabilité des gouverneurs locaux ou de l'Amiral de France |
||
| Les maîtres des requêtes sont des fonctionnaires du roi chargés au XVIe siècle de tournées d'inspection (chevauchées) dans les provinces. Ces tournées permettent de maintenir sous contrôle les administrations locales des pays d'élection qui isolées pourraient montrer quelques velléités d'indépendance. |
||
| Ouvrier, ouvrière qui travaille de ses mains et à la journée. Il n'a ni charrue, ni attelage suffisant. En général, il possède quelques parcelles, une petite maison, un petit jardin, quelques moutons et quelques poules, et il peut produire une partie des grains dont il a besoin. Il se situe donc au-dessus du pur journalier qui n'a que ses bras. Mais il doit travailler une grande partie de son temps, en particulier au moment des grands travaux d'été et d'automne (fenaison, moisson, vendanges, labours, semailles), pour le compte des laboureurs qui ont besoin d'une importante main-d'oeuvre saisonnière |
||
| La définition de la manufacture de
l'ancien régime correspondrait aujourd'hui au terme d'usine puisqu'il
s'agit de l'endroit où plusieurs ouvriers ou artisans sont rassemblés
en vue de produire des marchandises de même nature. On distinguait
les |
||
| Fournisseurs du roi dispensés de toute obligation corporative. Ils assurent l'approvisionnement des résidences royales et hauts dignitaires. Appartenant à une centaine de métiers différents, ils sont fiscalement privilégiés et ne dépendent que du seul Prévôt de l'Hôtel. | ||
| Charge créée par Charles VIII en 1498 pour "écrire, peindre et blasonner" dans les répertoires publics le nom et les armes de toutes les personnes autorisées à en porter. En 1615, Louis XIII pour satisfaire la noblesse crée une charge de juge d'armes pour régler les contestations résultant des usurpations d'armoiries. |
||
| Primitivement, ce titre désignait un officier de l'écurie du roi mais sous l'ancien régime il s'agit de la plus haute dignité à laquelle il était possible de s'élever dans l'armée. Le Maréchal de France était cousin du roi et on lui devait le titre de "Monseigneur". |
||
| Matriculaire |
Celui dont le nom est dans la matricule. Ce mot se trouve dans la Déclaration
du 31 Mars 1674. enregistrée au Parlement le 16 Avril suivant,
concernant les quatre cents Procureurs du Parlement. |
|
|
A la fin de l'ancien régime le corps
des médecins avaient encore une place dans la hiérarchie
sociale, un peu plus élevée que les chirurgiens. En 1765
ils sont assimilés aux avocats
et bourgeois vivant noblement tandis
que les chirurgiens ont le même rang que les négociants en
gros. |
||
| Joueur de violon ou d'autre instrument qui fait danser dans les villages. A Paris, ils formaient une corporation importante et avaient une autorité qui s'étendait à tout le royaume.Toutefois, l'Académie royale fondée en 1661 les évinça peu à peu, surtout lorsqu'ils revendiquèrent le monopole de l'enseignement de la danse et la musique. La corporation disparut en 1776. |
||
| Importante corporation vendant
un peu de tout, notamment des produits de luxe (broderies, draps d'or
et d'argent, pierres précieuses....) Ils étaient l'un des
6 grands corps de marchands. |
||
| * Relevé périodique
sur un marché des prix des céréales
et autres denrées comestibles. |
||
| Gardien des moissons, des récoltes |
||
| Les offices de mesureurs de grains sont très nombreux sur les quais, ports et marchés et formaient à Paris une corporation importante. | ||
|
|
||
| Locataire d'une exploitation dont le loyer consiste en une part de la récolte. | ||
| Sous l'ancien régime, on distingue les métiers
libres et les métiers jurés. Les premiers sont ouverts à tous et dominent au XVIe siècle. Le règlement est fixé par le seigneur ou la municipalité. (= corporations lyonnaises) Les seconds sont des communautés dans lesquelles on entre en prêtant serment et qui ont leur règlement propre. (= communautés parisiennes) Hiérarchisés, ces métiers sont protégés par les pouvoirs publics et s'organisent en confréries aussi bien d'ouvriers que de maîtres.. |
||
| Haut personnage de l'état qui avait entrée au conseil d'en haut qu'il soit ou non, chef de département ministériel (tout personnage appelé par le roi à y siéger était désormais qualifié du titre de ministre d'état jusqu'à la fin de sa vie) |
||
| ou "premier ministre". Le principal ministre d'état, homme de confiance du roi jouait le rôle d'intermédiaire entre le roi et les autres ministres qui sont en quelque sorte ses subordonnés. Sully sous Henri IV, Richelieu sous Louis XIII, Mazarin pendant la minorité de Louis XIV... ont assumé cette fonction. A la mort de Mazarin, le roi âgé de 22 ans décida de personnellement gouverner et garda cette fonction jusqu'à sa mort. Colbert, fut souvent à tort qualifié de premier ministre car s'il exerçait des pouvoirs extrèmement étendus à travers tout le royaume, il n'eut jamais la moindre autorité sur les autres ministres d'état. Les périodes suivantes oscillèrent toujours entre présence et absence de premier ministre comme si la prise de pouvoir de Louis XIV avait en quelque sorte moralement obligé ses successeurs à agir de même. Lorsqu'il y eut un ministre principal ses fonctions ne furent jamais aussi bien définies que sous Sully, Richelieu et Mazarin. |
||
| Officier
public établi pour recevoir des actes
et contrats, personne chargée par l'état de la rédaction,
de l'authentification et de la conservation des conventions conclues entre
des particuliers. Ils devaient être de religion catholique, attester
de leur bonne vie & moeurs et subir un examen au Châtelet
de Paris. |
||
| Communauté des notaires parisiens qui vit en complète autarcie et première communauté du royaume tant par le nombre de ses membres que par ses privilèges. |
||
| Sous l'ancien régime,
les fonctions publiques étaient établies soit : |
||
| Tout titulaire d'un office civil, d'une charge militaire ou d'un grade. |
||
| Livre dans lequel on note les salaires, mais aussi le travail confié aux ouvriers |
||
| Financier qui prenait en charge la levée d'un impôt ou droit quelconque et le levait généralement avec une avidité qui en faisait un objet de haine et des bénéfices qui en faisait un objet d'envie. (synonyme de traitant) |
||
| Seules les villes de Paris et Lyon avaient un Prévôt des marchands nommé par le roi pour 6 ans à partir d'une liste de 3 noms proposés par un conseil de notables de la ville. A Paris, il partageait la gestion de la capitale avec le lieutenant de police, le Parlement et le Châtelet. Il s'occupait plus particulièrement de la navigation fluviale, de l'entretien des quais, des ponts, des fontaines, de l'approvisionnement en blé par voie d'eau, des fêtes. L'administration dans laquelle il exerçait était le Bureau de la ville. | ||
| Officier d'épée, prévôt de l'hôtel du roi exerçant une juridiction importante relative à la sûreté et à la subsistance de la cour et des endroits où le roi résidait. Il avait sous ses ordres une compagnie de 68 gardes et 25 officiers ou sous officiers, tandis que 65 autres gardes servaient auprès des intendants dans les provinces. |
||
| Juge militaire,établi
par François Ier pour juger sans appel les crimes et délits
des vagabonds, déserteurs, mendiants, repris de justice, auteurs
de vols avec effraction, émeutes populaires, faux-monnayeurs...
De chacun des Prévôt des maréchaux dépendait
une maréchaussée. |
||
| Notable aux attributions surtout honorifiques placé à la direction du Châtelet. |
||
| Charge extrèmement
impopulaire créée en 1556 dans toutes les villes et bourgs
du royaume qui consistait a avoir l'exclusivité des prisées,
expropriations et ventes de meubles qu'elles soient volontaires ou ordonnées
par la justice contre une rémunération de leurs services élevée
accompagnée de frais de déplacement... En 1789, des cahiers de doléances leur reprochent d'absorber tout l'actif des petites successions tant leurs frais sont importants. L'un d'eux dira même "On voit ces hommes, l'horreur de l'humanité, se transporter chez des orphelins pour en inventorier les effets, s'arroger 50 sols par lieue de voyage..." |
||
| Officier
public qu’on a ensuite nommé « avoué ».
Très tôt la charge devint
vénale ce qui conduisit à
la multiplier à outrance. En 1620 un édit
constate que leur nombre est si excessif qu'ils ne peuvent plus gagner
leur vie sans avoir recours à d'autres expédients, y compris
parfois à la malhonnêteté. Ils étaient souvent
accusés de provoquer et faire durer les procès. |
||
| Officier partageant avec les avocats du roi ou les avocats généraux les fonctions du ministère public devant les tribunaux. |
||
| Officier qui dans les juridictions seigneuriales de haute justice représentait le seigneur en défendait ses droits et intérêts. C’est le personnage le plus important de ces petits tribunaux |
||
| Toutes les administrations financières
avaient leurs receveurs, souvent en nombre important car les caisses étaient
généralement multipliées à l'excès. |
||
|
Collecteur de l'impôt direct dans sa circonscription, la généralité établi par François Ier en 1542. Au XVIIIe siècle, il y avait 24 recettes générales (20 généralités des pays d'élections + Flandre, Lorraine, Alsace, et Franche-Comté) et 48 receveurs généraux. |
||
| Le recrutement dans l'armée s'effectuait sur la base
- théorique - du volontariat mais en réalité les pratiques
auxquelles les recruteurs se livraient ont figuré parmi les pires
abus de l'ancien régime. Enlèvement, ruse, mensonge, tout
était bon pour remplir les armées du roi, surtout pendant
les grandes guerres de la fin du règne de Louis XIV. Au XVIIIe siècle quelques tentatives eurent lieu visant à lutter contre les abus du racolage et un engagement ne pouvait plus se faire que passé devant le recruteur en uniforme, signé et avec déclaration qu'il était librement contracté. Si la recrue ne savait signer, le contrat ne pouvait être validé qu'en présence de 2 témoins. Toute violence fut interdite. |
||
| Marchand qui vend au détail légumes,
fruits, épices, et surtout sel. Le grenier
à sel ne peut fournir de petites quantités ; le regrattier
s'y approvisionne et revend dans la limite d'une livre
et demie, le sel à ceux dont les besoins sont peu importants. Le
prix est souvent bien plus élevé qu'au grenier à
sel. |
||
| Les propriétaires d'un office pouvaient le résigner (le transmettre) à qui ils voulaient à condition de survivre 40 jours à cette résignation. La paulette fut créée en 1604 pour permettre de racheter cette nécessité de survie de 40 jours. |
||
| Registre contenant les délibérations d'un corps de métier |
||
| Profession qui exigeait d'avoir suivi une formation, d'être de religion catholique, de savoir baptiser (ondoiement) et d'être de bonne vie et moeurs. Elles étaient soumises à l'approbation de l'évêque (ou du curé) et juraient à leur entrée dans la profession de procurer le salut, tant spirituel que temporel à la mère et l'enfant. Malgré tout, les sage-femmes (surtout en campagne) étaient vivement décriées du fait de leur ignorance et maladresse et beaucoup refusaient assistance aux malheureuses incapables de payer leurs prestations. |
||
|
Au début du XVIIIe siècle le salaire des ouvriers agricoles est d'environ 7 à 10 sous mais dans certaines régions il peut être beaucoup plus élevé. Au cours du siècle, une inflation galopante gonfle tous les prix y compris le niveau les salaires et dès 1722, les journaliers demandent 20 ou 25 sols par jour. L'escalade se poursuivra jusqu'à la révolution. |
||
| Les ateliers des salpêtriers devaient fournir les quantités de salpêtre nécessaires à la fabrication des poudres et bénéficiaient pour cela de grands privilèges notamment celui de pouvoir entrer dans toutes les maisons et caves où pouvait se trouver du salpêtre sans que les habitants ne puissent s'y opposer. |
||
|
Expression méprisante désignant une charge anoblissante |
||
| Très tôt, le roi
a eu besoin d'un bon secrétaire, fonction d'abord remplie par le
chancelier bientôt assisté
par des "notaires". Ces derniers qui s'occupaient des "secrets
du roi" ont pris le nom de secrétaires du roi. |
||
| Les secrétaires d'état
travaillent directement avec le roi et participent aux conseils. Chaque
jour le roi leur donne audience, ils exposent les affaires, proposent
des solutions tandis que le roi décide. A la mort de Louis XIV
ils seront pour un temps écartés du pouvoir mais les réformes
des conseils ayant échoué, dès 1718 on leur restitue
leurs attributions et les choses reprennent leur cours normal. |
||
|
Autrefois, officier
de justice chargé des fonctions inférieures comme signifier
les assignations, faire les saisies ou procéder aux arrestations.
|
||
| Homme commis à la garde des vignes quand le raisin commence à mûrir. Voir messerie |
||
|
Grandes corporations privilégiées
de la capitale : merciers, épiciers,
drapiers, changeurs, orfèvres et pelletiers. |
||
| Jusqu'en 1704, les subdélégués
sont les hommes de confiance des intendants
qui confrontés à des charges de plus en plus importantes,
les nomment et révoquent à leur gré. Chacun a alors
la charge d'une partie de la généralité.
|
||
| C'est en 1561 que la surintendance
des Finances est créée pour désigner le personnage
placé à la tête du département des finances.
Il avait autorité sur les trésoriers
de France, les généraux des finances, les trésoriers
de l'épargne qui centralisaient toutes les sources de revenus.
|
||
| Avant et pendant une grande partie du Moyen Age, les boulangers, pour faire du pain, étaient obligés de tamiser la mouture grossière provenant du blé, de l'orge, du seigle, etc. De là vient le nom de talmelier ou talemelier |
||
| voir "gages" | ||
| Quelques fermiers généraux, appelés tourneurs, étaient à tour de rôle chargés de faire des tournées en province. | ||
| Personne ayant obtenu, contre paiement, le droit de lever un impôt, droit ou créance à son profit. Leur nom provenait du traité conclu dans ce but. (synonyme : partisan) |
||
| Officier exerçant des les Cours du Trésor, puis à partir de 1577 dans les bureaux des finances. Il avait compétence en matière de tailles, domaine (droits féodaux ou seigneuriaux, de la remise des aveux et dénombrements) et voirie. La charge était une noblesse graduelle (anoblissait au second degré), sauf celle du bureau de Paris qui était au premier degré (20 ans ou mort en charge). |
||
| Les pays d'état, et plus particulièrement les 3 plus importants (Bretagne, Languedoc et Provence) avaient à la tête de leur administration financière des trésoriers généraux dont le rôle était de servir de banquiers à leur province, mais aussi au roi et à nombre de particuliers. |
||
| Valet
|
T. n. m. Il y a plusieurs sortes
de valets. Premier Valet de Chambre du Roi, est un Officier considérable
de sa Maison qui couche aux pieds de son lit, qui est toujours dans sa
chambre, qui garde sa cassette, &c. Il y a quatre premiers Valets
de chambre. |
|
| Conséquence directe des grands besoins d'argent du Trésor royal, la vénalité des charges est le fait de mettre en vente les fonctions publiques (offices). Elle s'est d'abord développée sous Louis XII qui passa son règne à l'interdire mais à la pratiquer, suivi par François Ier qui à la faveur des guerres d'Italie en fit un usage plus large mais il fallut véritablement attendre le règne de Louis XIV pour que le système prenne des proportions considérables et représente une part importante du budget de l'état. La vénalité des charges fut abolie en 1789 lors de la nuit du 4 août. |
||
| Officier des eaux et forêts qui avaient sous leur garde et juridiction une certaine étendue de bois et forêt appelée verderie et qui étaient hiérarchiquement placés sous le maître des eaux et forêts, mais au-dessus des gruyers qui disposaient d'une circonscription moins étendue. |
||
| Droit pour un ancien officier ayant exercé un certain temps son office de continuer à jouir, après l'avoir quitté, de ses honneurs et prérogatives. En 1669, le délai d'exercice requis était de 20 ans ; en 1704, un nouvel édit abaissa cette durée à 15 ans moyennant finance, avant de l'établir à 20 ans pour les officiers de justice et 25 ans pour ceux de la maison du roi | ||
| Vicomte |
Nom de dignité sans autorité,
& sans Jurisdiction. Celui qui a une Terre ou Seigneurie érigée
sous le titre de Vicomte.
|
|